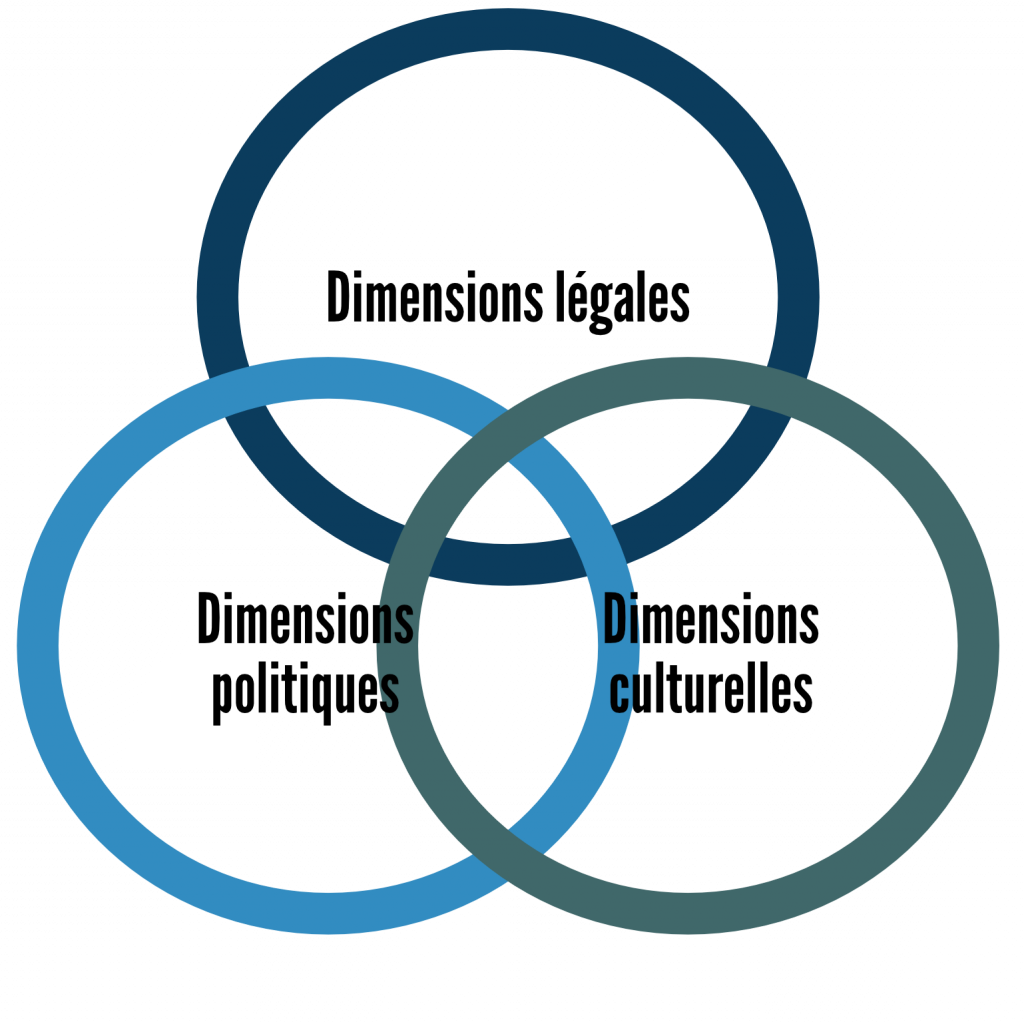References
- Convention relative au statut des réfugiés, 1951, https://www.unhcr.org/fr/4b14f4a62
- Note du traducteur, la version anglaise de la convention utilise un langage propre à elle-même qu’il vaut d’analyser. Il faut identifier l'ambiguïté dans l’affirmation, elle est présentée différemment dans les deux langues.
- Comme l’indique Susanne Lachenicht, le premier usage de ce mot en anglais fait référence à des protestants français fuyant la persécution. Les cas antérieurs de mouvement de réfugiés utilisent les mots “exiled” ou “refuged” en anglais, c’est-à-dire “se réfugier” ou “to seek asylum.” Un terme qui apparaît en français tôt au quinzième siècle. Lachenicht, Susanne. “Refugees and Refugee Protection in the Early Modern Period.” Journal of Refugee Studies 30, no. 2 (2016), note de bas de page 1, p. 277.
- un bon exemple de l'ambiguïté entre l’usage des termes réfugiés et immigrants se trouve ici https://boatpeoplehistory.com/rp/media-repr/gm/
- Mike Molloy a interviewé Tove Bording, une agente d’immigration à Singapour entre 1975 et 1977, qui pensait avoir inventé le terme afin de distinguer entre les cas de mer et les cas de terre. La date du rapport où cette distinction aurait été effectuée demeure cependant inconnue. Molloy, M.J., Duchinsky, P., Jensen, K. F., & Shalka, R. (2017). Running on empty, Canada and the Indochinese Refugees, 1975-1980. Montréal: McGill University Press, p. 189. Voir aussi Molloy, M. J. (2014). Obituary. The Canadian Immigrations Historical Society Bulletin, 71, 11.
- Une recherche rapide des archives de périodiques démontre qu’il apparut au Los Angeles Times le 13 juin 1976 pour parler des réfugiés en Thaïlande et au Vietnam.
- Tsamenyi, M. (1983), ‘The “Boat People”: Are They Refugees?’, Human Rights Quarterly, 5 348–73.
- Goodwin-Gill, Guy. “The Politics of Refugee Protection.” Refugee Survey Quarterly 27, no. 1 (2008): 8–23.
- Voir par exemple Zolberg, A., A. Suhrke, and S. Aguayo (1989), Escape From Violence: Conflict and the Refugee Crisis in the Developing World, New York: Oxford University Press, Soguk, N. (1999), States and Strangers, Refugees and Displacement of Statecraft, Minneapolis: University of Minnesota Press. Haddad, E. (2008), The Refugee in International Society, Between Sovereigns, Cambridge: Cambridge University Press, Madokoro, L. (2016), Elusive Refuge, Chinese Migrants in the Cold War, Cambridge: Harvard University Press, Akoka, Karen. “Crise Des Réfugiés, Ou Des Politiques D’asile ?” La Vie des idées (2016): Accessed 20 août 2020, https://laviedesidees.fr/Crise-des-refugies-ou-des-politiques-d-asile.html.
- Voir Horne, John, et Alan Kramer. German Atrocities, 1914: A History of Denial. New Haven: Yale University Press, 2002, et Puseigle, Pierre. “”A Wave on to Our Shores”: The Exiles and Resettlement of Refugees form the Western Front, 1914–1918.” European Journal of East Asian Studies 16, no. 4 (2007): 427–44.
- Bakewell, Oliver. “Research Beyond the Categories: The Importance of Policy Irrelevant Research into Forced Migration.” Journal of Refugee Studies 21, no. 4 (2008): 432–53.
- Zetter, Roger. “Labelling Refugees: Forming and Transforming a Bureaucratic Identity.” Journal of Refugee Studies 4, no. 1 (1991): 39–62, Zetter, Roger. “More Labels, Fewer Refugees: Remaking the Refugee Label in an Era of Globalization.” Journal of Refugee Studies 20, no. 2 (2007): 172–92.
- Hyndman, Patricia. “The 1951 Convention Definition of Refugee: An Appraisal With Particular Reference to the Case of Sri Lankan Tamil Applicants.” Human Rights Quarterly 9 (1987): 49–73.
- Fiddian-Qasmiyeh, Elena. “Representing Sahrawi Refugees’ “Educational Displacement” to Cuba: Self-Sufficient Agents or Manipulated Victims in Conflict?” Journal of Refugee Studies 22, no. 3 (2009): 323–50.